Les montagnes, véritables sanctuaires de biodiversité, jouent un rôle fondamental dans l’équilibre écologique mondial. Elles ne se contentent pas de dessiner le paysage ; elles sont sources de vie, offrant eau potable, ressources alimentaires et énergies renouvelables. Pourtant, sous la pression des activités humaines et des changements climatiques, ces écosystèmes fragiles sont en péril. Face à cette menace croissante, la préservation des massifs montagneux s’impose comme une nécessité absolue.
Bien plus que de simples reliefs, les montagnes assurent la régulation des écosystèmes et participent à la survie de millions d’espèces. Selon la Nation, une étude de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), montre que les montagnes fournissent entre 60 et 80 % de l’eau douce mondiale et abritent 15 % de la population terrestre. Leur contribution à la sécurité alimentaire est tout aussi capitale. Car, plusieurs espèces végétales essentielles à l’alimentation humaine, telles que le blé, le maïs ou encore la pomme de terre, trouvent leur origine dans ces régions.
Mais leur rôle dépasse le cadre écologique. Les montagnes sont également des moteurs économiques à travers l’agriculture, l’exploitation forestière et les énergies renouvelables. Leurs rivières alimentent des centrales hydroélectriques, tandis que leur climat et leur biodiversité favorisent des productions de qualité comme le café, le miel ou les épices.
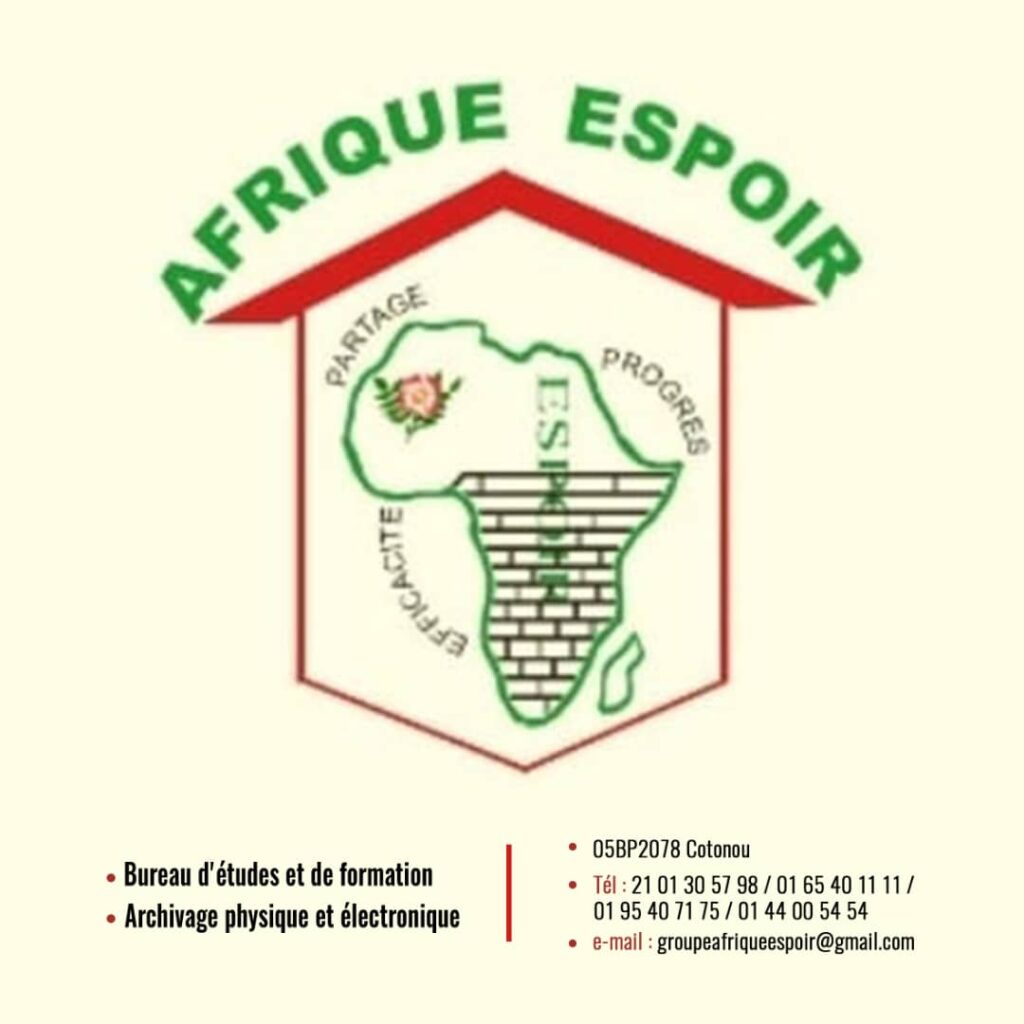
Les montagnes ne sont pas seulement des ressources naturelles, elles sont aussi des symboles culturels et spirituels pour de nombreuses civilisations. Certaines sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis que d’autres abritent des traditions séculaires transmises de génération en génération.
D’après La Nation, le tourisme en montagne, quant à lui, représente une part importante de l’industrie touristique mondiale, avec une contribution estimée entre 15 et 20 %. Que ce soit pour l’escalade, le ski ou la découverte de paysages à couper le souffle, ces régions attirent chaque année des millions de visiteurs.
Les montagnes de l’Atacora : un trésor à préserver
Au Bénin, le département de l’Atacora se distingue par ses reliefs majestueux et ses sites naturels uniques. Conscients du potentiel de cette région, les acteurs locaux se mobilisent pour sa valorisation. Lors de la Journée internationale de la montagne, célébrée le 11 décembre 2024 à Natitingou, les discussions ont porté sur le thème : « Solutions de montagne pour un avenir durable : innovation, adaptation et jeunesse ». L’objectif consiste à trouver des solutions concrètes pour concilier le développement et la conservation de ces patrimoines.
Cependant, les montagnes béninoises, comme tant d’autres à travers le monde, font face à des défis majeurs tels que la déforestation, la pression démographique, la perte de biodiversité et impacts du changement climatique. Ces menaces appellent une réaction urgente et coordonnée.
Mobilisation collective pour un avenir durable
Faut-il le rappeler, Michel Nahouan, directeur exécutif de Bénin Culture Développement Amitié (BCDA), insiste sur la nécessité d’une action gouvernementale forte. « Le gouvernement a récemment annoncé la création d’une agence dédiée à la conservation du patrimoine immatériel des montagnes. C’est une avancée significative qui témoigne d’une volonté politique réelle de protéger cet écosystème », souligne-t-il selon la même source.
Mais la préservation des montagnes ne peut être l’affaire des seules autorités. À en croire le média, Gnon Ganni Bassongui, membre du Comité scientifique du patrimoine culturel immatériel, rappelle que l’implication des jeunes est essentielle. « Il faut leur donner les outils et les opportunités de s’engager activement. Ce sont eux qui garantiront la pérennité des efforts entrepris aujourd’hui », affirme-t-il.
Il faut retenir que protéger les montagnes, c’est assurer la préservation de la biodiversité, garantir la sécurité alimentaire et lutter contre le changement climatique. Cet écosystème vital ne peut survivre sans une prise de conscience collective et une mobilisation accrue des gouvernements, des scientifiques, des populations locales et de la jeunesse. Il est temps d’agir.
Faboladji Abèrèkéré


