Le Bénin connaît une avancée notable en matière de monnaie électronique dans l’Afrique subsaharienne. Il affiche désormais un taux de détention de comptes de monnaie mobile supérieur à la moyenne. Cette dynamique , résultat de l’évolution des réseaux GSM présage de nouvelles opportunités pour l’inclusion financière et la modernisation du secteur bancaire sur le territoire national.
Malgré les défis persistants, le Bénin connaît une progression constante en matière de modernisation de son système financier au sein de l’Uemoa. Le système bancaire peine encore à élargir sa base de crédit et à mobiliser des capitaux à long terme, mais le rapport pays 2025 de la banque africaine pour le développement ( BAD) est encourageant grâce à la progression soutenue de la monnaie électronique. Selon les statistiques ,37 % de la population béninoise âgée de 15 ans et plus possède un compte de monnaie mobile en 2024. Ce pourcentage reste supérieur à la moyenne en Afrique subsaharienne estimée à 33 % en 2021.
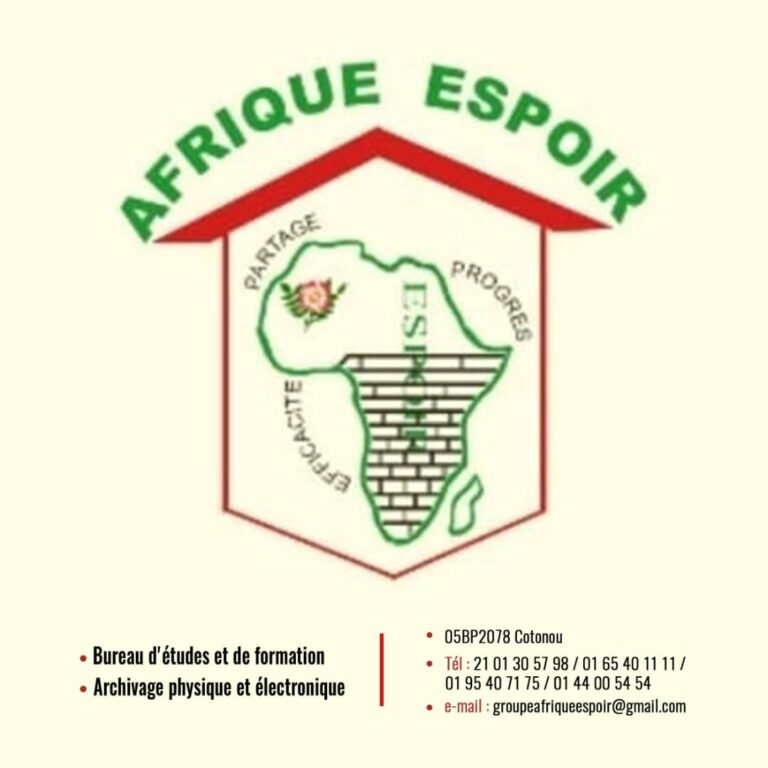
Cette prouesse se trouve contrastée avec le taux de détention de comptes bancaires traditionnels, qui s’évalue à 49 % pour les jeunes de 15 ans et plus, en dessous de la moyenne régionale de 55 %. Dans ce cadre où le secteur bancaire est essentiellement constitué de prêts à long terme, la progression de la monnaie mobile est une aubaine qui pallie les limites du système bancaire classique. Il faut noter que le secteur bancaire béninois, composé de 14 banques, dont neuf internationales et cinq régionales, fait face à des défis structurels : faiblesse de l’épargne nationale (21,9 % du Pib en 2024), crédits au secteur privé limité (19,7 % du Pib).
Les enjeux de la monnaie mobile
Au vu des difficultés du secteur bancaire classique, l’essor de la monnaie mobile est un miracle. Il est un alternative sûre , accessible et sécurisée pour atteindre les populations éloignées du système bancaire traditionnel et favorise largement l’essor économique.
L’inclusion financière est dès lors contrôlée par les opérateurs de téléphonie mobile, qui multiplient les services accessibles via téléphone portable : paiements, transferts d’argent, microcrédit, épargne mobile. Ces services sont d’ailleurs très appréciés et sont préférés par la population au détriment des banques, qui pour la majorité est inaccessible à cause de l’aspect géographique et administratif.
Défis et solutions potentiels
Il est faut noter que malgré la progression encourageante de la monnaie mobile, plusieurs défis entravent sa transformation en un moteur de développement incontesté dans l’Afrique subsaharienne. Pour assurer l’évolution constante de la monnaie électronique, il faudra réglementer l’ expansion en veillant à renforcer la sécurité des transactions et la protection des données personnelles.
Par la suite, il faut une interactivité et interconnexion entre opérateurs de mobile money, banques et autres acteurs financiers pour éviter la fragmentation du marché.
D’après la banque pour le développement ,il est nécessaire d’élargir l’offre de services financiers digitaux, en incluant des produits avec de la plus-value tels que : la micro-assurance, le financement agricole, la collecte de taxes locales. La digitalisation ne doit pas se limiter aux simples transferts d’argent, sous peine de freiner l’impact global sur l’économie réelle. Les banques sont également appelées à s’inscrire dans cette dynamique pour se repositionner stratégiquement.
Les leviers pour moderniser le système financier et améliorer l’accès au crédit doivent être mises en place. D’après le rapport pays 2025, un renforcement des capacités est impératif dans les domaines suivants :trésorerie nette et gestion des risques, digitalisation des services, finance climatique ou islamique. L’essor de l’intelligence artificielle peut se révéler être un atout de taille et pourrait constituer un virage stratégique dans le système financier au Bénin. L’automatisation des opérations, l’analyse prédictive du risque de crédit, la lutte contre la fraude ne sont pas à omettre pour suivre la dynamique entamée par le Bénin pour redorer son système financier au sein de l’UEMOA et dans l’Afrique subsaharienne.
Huguette Hontongnon


