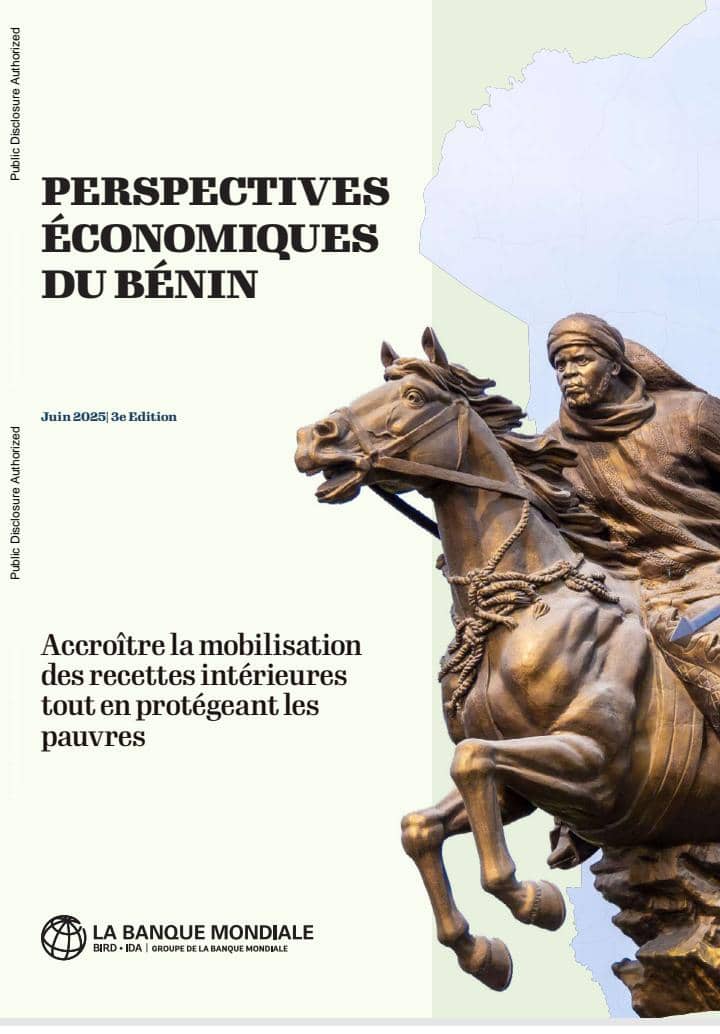La troisième édition du rapport de la banque mondiale sur les perspectives économiques du Bénin est déjà disponible. Il est composé de deux chapitres. Le premier chapitre est consacré à l’évolution récente de l’économie et aux perspectives à moyen terme. Le second chapitre examine les performances récentes en matière de mobilisation des recettes intérieures et évalue les implications du régime fiscal sur la pauvreté. L’objectif visé est d’informer les autorités de la République du Bénin, les groupes de réflexion, les chercheurs et les universitaires, ainsi que le public au sens large, de l’état de l’économie béninoise, de ses perspectives, ainsi que des défis immédiats de développement auxquels elle est confrontée. Selon le rapport, la croissance économique du Benin continue d’augmenter bien que la croissance mondiale reste stable et modeste en Afrique subsaharienne.
D’après les informations contenues dans le rapport, en 2024, la croissance économique du Bénin a atteint 7,5 %, son niveau le plus élevé depuis 1990, grâce aux solides performances des secteurs des services et de l’industrie. Le rapport souligne que le secteur des services, principal moteur de la croissance, a progressé de 7,5 %, contribuant à hauteur de 3,6 points de pourcentage (pp) à la croissance globale. « Le secteur agricole a enregistré sa contribution la plus élevée depuis 2019, tirée par la forte production du coton et des cultures d’exportation. Le secteur secondaire a enregistré une croissance de 9,7%, soutenu par les projets de construction dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG-2) et le développement des industries manufacturières avec la Zone Industrielle de Glo-Djibé (GDIZ). Du côté de la demande, la croissance a été soutenue par l’augmentation des exportations nettes, la forte consommation privée et l’investissement, malgré une contraction des investissements publics. Le dynamisme de l’investissement privé a contribué à atténuer l’impact de la réduction de l’investissement public » lit-on dans le rapport.
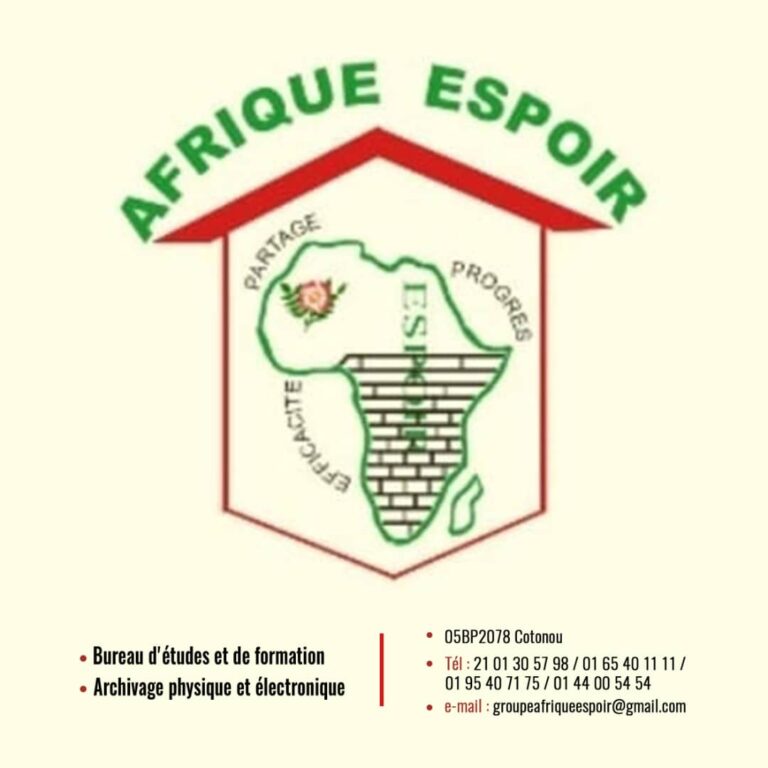
Le rapport renseigne que l’inflation globale a reculé à 1,2 % en 2024, contre 2,7 % en 2023, en raison de la modération des prix de l’énergie et des transports. L’inflation de l’énergie est passée d’une moyenne de 13,6 % en 2023 à 1,2 % en 2024, ce qui a freiné l’inflation des transports de 11,5 % à 1,1 %. Cependant, l’inflation des produits alimentaires a doublé pour atteindre 0,8 % en raison des pressions sur les marchés régionaux et de la fermeture de la frontière avec le Niger. « Le faible niveau d’inflation ajouté au dynamisme de l’activité économique se sont traduits par une baisse de 2.2 pp du taux de pauvreté national à 31%, contre une baisse de 1.5 pp en moyenne en 2021-22. La croissance du crédit à l’économie a ralenti, reflétant le resserrement des conditions de financement dans le secteur financier de l’UEMOA. La BCEAO a maintenu ses principaux taux directeurs inchangés, entrainant une augmentation des coûts d’emprunt et une baisse de la croissance des crédits aux sociétés non financières privées, de 13,9 % en 2023 à 4,6 % en 2024. Le secteur financier est resté solide, avec des prêts non performants de l’ordre de 4 % à la fin de 2024 » précise le rapport.
Le rapport a également fait savoir qu’en 2024, le Bénin a atteint l’objectif de déficit budgétaire de l’UEMOA de 3 % du PIB, contre 4,1 % en 2023, grâce à une mobilisation accrue des recettes intérieures et à la réduction des dépenses d’investissement. L’objectif a été atteint une année avant. Les études ont montré que le déficit du compte courant s’est réduit à 7 % du PIB en 2024, contre 8,2 % en 2023, en raison de la hausse des exportations nettes de biens. La reprise des exportations de coton, la diversification des cultures d’exportation et l’augmentation de la valeur de l’agro-industrie ont tiré l’augmentation des exportations.
Selon le rapport, les perspectives sont orientées à la baisse en raison des problèmes de sécurité, des incertitudes économiques et des problèmes climatiques. Mieux, le Bénin est sur le point de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales avec le développement de la zone industrielle spéciale, mais les incertitudes croissantes entourant le commerce mondial et l’instabilité des relations commerciales avec les pays voisins pourraient compromettre ces perspectives. « La mobilisation des recettes au Bénin est en hausse constante depuis 2016, tirée par de bonnes performances en matière de recouvrement des impôts. Les recettes totales et dons ont atteint 15 % du PIB en 2024. La mobilisation des recettes a démontré une résilience face à divers chocs, notamment la fermeture des frontières, la pandémie de la COVID-19, la crise du coût de la vie en 2022 et la montée de l’insécurité. Les recettes totales, y compris les dons, qui étaient passées de 13,5 % du PIB en 2013 à 11,1 % du PIB en 2016, ont augmenté régulièrement pour atteindre 15% du PIB en 2024 grâce à la modernisation de l’administration fiscale et à la numérisation accrue des principaux processus fiscaux. Les recettes fiscales, principal moteur de l’augmentation des recettes, sont passées de 9.2 % du PIB en 2016 à 13,2 % en 2024, tandis que les recettes non fiscales représentaient en moyenne 1,6 % du PIB, en moyenne entre 2021- 2024. Les impôts indirects ont été le principal contributeur à la croissance des recettes fiscales, augmentant de 2,5 points de pourcentage (pp) du PIB entre 2016 et 2024, la TVA atteignant environ 5 % du PIB en 2024. Les taxes sur le commerce international ont représenté en moyenne 2,3 % du PIB, tandis que les droits d’accise ont augmenté à 0,5 % du PIB en 2020 avant de diminuer. Les contributions de la fiscalité directe n’ont augmenté que de 1.6 pp du PIB, tirées par les performances de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (0.6 pp) et l’impôt sur le revenu des sociétés (0.4 pp). L’impôt foncier n’ayant augmenté que marginalement à 0,1 % du PIB malgré des récentes réformes » révèle le rapport.
Les cinq facteurs ayant favorisé la résilience de l’économie béninoise selon le rapport
- Diversification de l’agriculture. L’activité économique était auparavant volatile, en raison de la vulnérabilité du secteur agricole aux chocs externes, notamment aux chocs climatiques et aux prix des matières premières, mais la diversification des cultures d’exportation et l’amélioration de la résilience des semences ont contribué à soutenir la croissance du secteur. La production agricole a été particulièrement touchée en 2020 et en 2022-23 avec la baisse de la production de coton. Toutefois, l’essor des exportations de noix de cajou et de soja a compensé l’impact.
- L’industrialisation avec le développement des industries agroalimentaires. La contribution des industries manufacturières à la croissance a augmenté de 0,2 pp sur les deux périodes avec le démarrage de la production à la GDIZ.
- Diversification des services avec le développement des télécommunications et l’émergence d’un secteur touristique dynamique. L’amélioration de la qualité des infrastructures et le développement du secteur touristique contribuent à la diversification des services. La contribution des deux sous-secteurs a augmenté d’environ 0,2 pp entre les deux périodes.
- Gestion macroéconomique saine. L’amélioration de l’espace budgétaire entre 2017 et 2019 a permis au gouvernement de mettre en œuvre une politique budgétaire contracyclique qui a soutenu l’exécution du Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026 (PAG-2). En conséquence, le secteur de la construction est resté dynamique, générant une croissance supplémentaire de 0,3 pp. En outre, les réformes et les investissements dans le secteur public (y compris l’éducation, la santé et la sécurité sociale) ont entraîné une croissance supplémentaire de 0,5 pp.
- Rôle du secteur informel. Malgré les incertitudes commerciales et les fragilités dans le Nord, la croissance des sous-secteurs du commerce et du transport a fait preuve de résilience, progressant en moyenne au même niveau. Si le secteur informel a servi d’amortisseur de chocs, en particulier pendant la fermeture des frontières, il entrave également la croissance de la productivité et la mobilisation des recettes. Le sous-secteur des transports a également bénéficié du dynamisme des sous-secteurs de la construction et des industries extractives.
Cependant, d’importants défis restent à relever par le Bénin
Le rapport révèle que :
- Les recettes fiscales ne sont pas encore à la hauteur des besoins de financement croissants du pays et restent inférieures à celles des pays comparables ;
- Les progrès vers l’amélioration de la mobilisation de l’impôt direct ont été inférieurs à ceux des pays comparables, et le Bénin est moins tributaire des impôts directs que ses pairs ;
- Le recouvrement de l’impôt direct reste inférieur à celui des pays pairs en raison de la taille du secteur informel et des exonérations fiscales qui minent la productivité et l’efficience des impôts ;
- L’efficience de la TVA est faible en raison de l’exonération et de l’étroitesse de l’assiette fiscale due à la taille importante du secteur informel ;
- Le taux de recouvrement des droits d’accise au Bénin a été très faible, malgré l’existence d’un large éventail de postes dans le panier des droits d’accise ;
- En plus d’améliorer l’efficience des recettes fiscales, le renforcement de la gestion des investissements publics peut favoriser l’adhésion aux réformes fiscales (en renforçant le contrat social) et élargir l’assiette fiscale ;
- Une convergence du système budgétaire vers celui des pays pairs pourraient soutenir les efforts de réduction de la pauvreté ;
- Si le Bénin se compare favorablement par rapport aux pairs de la région, l’amélioration de l’efficience pour converger vers le niveau des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure pourrait permettre d’atteindre un développement plus durable avec des niveaux de dépenses publiques similaires etc
Fiacre Awadji